Téléchargez la chronique l’Antoine Tricot du 22 juillet
Écoutez la chronique l’Antoine Tricot du 22 juillet
« Nous allons parler de l’Algérie, de liberté d’expression et de dictature. J’avais envie de parler de l’Algérie pas pour une quelconque commémoration, comme on a l’habitude de le faire, mais juste parce que nous n’en savons presque rien. À peine se souvient-on que la guerre d’Algérie s’est terminée en 1962, que le pays a subit une guerre civile dans les années 1990 et qu’il est aujourd’hui gouverné par Abdelaziz Bouteflika.
C’est aussi l’occasion de parler, un peu, de propagande en essayant d’aller un peu plus loin que les poncifs qu’on a l’habitude d’entendre…
Tout est parti d’un tweet de Pierre Haski, le directeur du site Internet d’information rue89, qui, le 29 juin dernier, envoyait une photo de la Une d’El-Watan, un journal francophone algérien, titrant alors « Comment le pouvoir étouffe les droits de l’homme ». Pierre Haski accompagnait alors cette photo de cette exclamation: « On ne peut pas dire que la presse algérienne soit muselée !»
Et effectivement. À lire l’article qui accompagne cette Une d’El Watan, on n’a pas l’impression que la presse soit à la botte du pouvoir en Algérie. Le journaliste fait un vif compte rendu du dernier rapport du Collectif des familles de disparus en Algérie rendu à Paris, à la fin du mois de juin. Comme le rapporte El Watan, le document de 149 pages fait une description exhaustive des violations des droits de l’homme en Algérie ces dernières années. il souligne notamment les dysfonctionnements du système judiciaire, le renforcement des lois coercitives en juillet 2012 et la régression générale des libertés fondamentales. L’article évoque même des cas de tortures dans les commissariats du sud du pays.
Donc, à la lecture de l’article, on apprend que l’Algérie n’est pas un pays libre, mais dans lequel on a le droit de dénoncer cette absence de liberté !
Le paradoxe mérite d’être souligné.
Un article parait librement dans un pays pour dire combien ce pays est dictatorial et autoritaire et combien la liberté d’expression, entre autres, y est bafouée. Ça a de quoi surprendre. Ça ne correspond pas du tout à l’image que l’on peut se faire communément d’une dictature qui, en général, s’accompagne du musellement visible des médias et d’une propagande directe « à la 1984 », de Georges Orwell. Or dans ce cas, comme le dit Pierre Haski, « on ne peut pas dire que la presse algérienne soit muselée…» puisque l’on y critique vertement le régime.
On pourrait citer l’exemple d’Internet aussi. Il n’y a pas sur les réseaux sociaux de véritable censure. Contrairement à ce qui se faisait dans la Tunisie de Ben Ali. Et chacun est « presque » libre de poster ce qu’il veut sur son Facebook et même parfois des photos de manifestations dans des lieux où celles-ci sont normalement interdites.
Du coup, si Internet et la presse algérienne semblent libres, on peut se poser la question de savoir si l’Algérie est vraiment une dictature. La question est rhétorique car, au vu du rapport que fait justement le Collectif des familles de disparus en Algérie, on peut répondre sans difficulté : oui, l’Algérie est une dictature.
Mais peut on réellement parler de dictature quand un pays est doté d’institutions démocratiques ?
C’est vrai que l’Algérie n’a cessé de mettre en avant une façade républicaine plus ou moins démocratique, mais, depuis la fin de la guerre d’indépendance en 1962, l’Algérie a vu se succéder des régimes autocratiques. Celui du FLN d’abord, puis celui des généraux et enfin celui d’Abdelaziz Bouteflika. Mais pendant tout ce temps jamais les institutions républicaines, calquées sur le modèle français, n’ont été supprimées. Même si elles ne sont plus que des coquilles vides dépourvues de tout pouvoir.
De même, des élections ont été régulièrement organisées pendant ces années et même si elles n’attirent même pas un tiers de l’électorat et qu’elles sont systématiquement dénoncées comme truquées, elles maintiennent l’illusion d’un semblant de débat politique auquel les algériens malgré toutes leurs critiques sont très attentifs. Bouteflika brandit d’ailleurs souvent l’exemple du parti travailliste, trotskiste, qui reçoit une vingtaine de sièges au parlement à chaque élection depuis 2002. Cela permet au président algérien de dire : « Regarder comme le pays est démocratique, on a même des trotskistes à l’assemblée ! »
Il faut savoir que la liberté de la presse est garantie par la constitution algérienne. Et qu’en arrivant au pouvoir en 1999, Bouteflika déclarait dans une interview donnée à l’Express être « un fervent admirateur du président Jefferson, lequel aurait préféré un pays où la presse est libre à un autre doté d’un bon gouvernement. » Et dernièrement, il faisait la promesse de libéraliser l’audiovisuel public et de publier une nouvelle loi organique sur la presse, censée « dépénaliser » le délit de presse.
Hélas, concrètement, personne n’est dupe. Tout ça n’est que des effets d’annonce qui n’ont quasiment aucune répercussion sur la réalité.
Le rapport du Collectif des familles de disparus en Algérie, dont nous parlions tout à l’heure, dénonce une situation préoccupante pour la liberté de la presse. La nouvelle loi organique promulguée en janvier 2012 n’a pas changé grand-chose pour les journalistes. Ils sont toujours poursuivis par le régime, comme le rapporte souvent Reporter Sans frontière. Manseur Si Mohamed, par exemple, journaliste et chef de bureau du quotidien francophone La Nouvelle République, a été condamné, au début de l’année dernière, à deux mois de prison ferme pour diffamation. Alors que l’article accusait simplement une directrice des impôts de ne pas avoir respecté une décision du Conseil d’Etat.
Pour ce qui est de l’audiovisuel public. La réforme attendue n’a rien changé non plus. Malgré le lancement de trois chaines thématiques, la télé est toujours aux ordres du pouvoir et les scènes de baisers dans les films diffusés sont toujours censurées. Et je ne vous parle même pas des informations…
Alors comment se fait-il que, dans ce contexte, le journal El Watan puisse critiquer le régime ?
On peut trouver plusieurs réponses à cette question.
Tout d’abord l’existence de quelques journaux indépendants fait partie de la façade démocratique dont nous parlions tout à l’heure. Au même titre que le maintien de syndicats et l’organisation d’élections factices. Cela permet surtout de sauver les apparences à l’étranger. Rappelons toute proportion gardée que le régime nazi lui-même avait maintenu jusqu’à l’aube de la seconde guerre mondiale certains journaux indépendants, dont le Frankfurter Zeitung, qui était à l’époque le journal allemand de référence le plus lu à l’étranger. Le but recherché était clair : troubler les démocraties occidentales sur la nature du régime et utiliser discrètement le journal sur des questions diplomatiques.
Les critiques portées par cette presse libre est d’autant plus indolore pour le pouvoir quelle s’adresse à une minorité de la population. El Watan est un journal francophone. Or 50 ans après l’indépendance du pays, qui parle encore français aujourd’hui encore en Algérie ?
La plupart des jeunes des classes populaires ont été soumis à la politique d’arabisation intensifiée dans les années 1980 et ne parlent aujourd’hui qu’un dialecte algérien à dominante arabe. Restent les personnes âgées qui ont appris le français à l’école, les classes dirigeantes et moyennes, les intellectuels et certains étudiants, notamment dans les filières scientifiques utilisant encore le français comme langue d’enseignement. La population étant très jeune en Algérie, cette frange est aujourd’hui minoritaire. Certes les intellectuels francophones continuent dans une certaine mesure à exprimer une pensée critique. Mais leur isolement sur le plan culturel, face à cette jeunesse de plus en plus tournées vers la culture arabe, les rend impuissants sur le plan politique.
Une amie algérienne directrice d’un centre de recherche à Alger me disait à ce sujet que ses positions féministes et critiques étaient connues de tous, mais que le problème n’était pas de dire les choses ni de savoir que le régime était corrompu, mais l’impuissance qu’elle ressentait ensuite au moment de passer au niveau de l’action politique.
Le spectre des assassinats durant la guerre civile est encore très présent dans les esprits. Sans parler des manipulations habiles du pouvoir pour faire taire les critiques. Le régime a ainsi offert aux intellectuels des postes à l’université et dans la haute fonction publique. Et au moment des révolutions arabes, ils ont reçus de fortes augmentations salariales et un an de salaire d’avance… En plus de ça, la ministre de la culture, ex-féministe et ex-révolutionnaire, n’hésite pas à limoger du jour au lendemain certaines des ses personnes jugées un peu trop remuantes. Sans oublier que Bouteflika s’appuie sur une police pléthorique et toute puissante qui réprime avec force toute tentative de mobilisation un peu trop sérieuse.
Bref, en Algérie on peut parler mais agir semble bien compliqué…
Vous ne pensez donc pas que la presse puisse donner l’impulsion d’un changement de régime en Algérie ?
Enfin une dernière raison peut expliquer qu’un journal critique soit toléré en régime autoritaire : tout simplement, son utilité politique. L’erreur est souvent de se représenter une dictature comme d’un seul bloc, monolithique. Or les luttes d’influences et les structures de pouvoirs y sont tout aussi nombreuses et complexes qu’en démocratie.
Aujourd’hui Bouteflika est gravement malade, il vient de passer près de 3 mois en France pour être soigné. En Algérie, sa succession se prépare activement et la lutte autour du pouvoir s’annonce acharnée. Certains généraux entendent maintenant reprendre l’influence que Bouteflika leur a lentement confisquée.
Les articles critiquant vertement la politique du président algérien actuel en matière de Droits de l’Homme, entre autre, ne sont pas pour leur déplaire. De même que les voix qui s’élèvent un peu partout pour dénoncer la corruption du système. Tout cela appelle un changement de régime dont ils souhaiteraient bien tirer profit.
Attention, je ne suis pas ne train de dire que les journalistes d’El-Watan sont coupables d’affinité avec une quelconque partie du régime. Au contraire ils se battent farouchement pour leur indépendance. Ils sont même criblés de procès en tout genre, et ils luttent vaillamment contre l’étranglement financier qui menace leur journal. Mais, je dis simplement, que l’ampleur de leur marge de manœuvre, de ce qu’ils peuvent dire ou pas, dépend beaucoup de la situation politique du pays et que parfois laisser un peu de mou sur la laisse de quelques médias peut s’avérer bénéfique pour certaines parties d’un pouvoir dictatorial.
Donc non, on ne peut pas dire que la presse soit muselée en Algérie. Mais on ne peut pas dire non plus que cette liberté d’expression mette en danger le pouvoir. La plupart des observateurs de l’Algérie d’aujourd’hui s’attendent plutôt à une lutte violente et peut être même sanglante pour la prise du pouvoir qu’a une révolte populaire et démocratique.
Mais à force de jouer à ce jeu dangereux d’une liberté d’expression sur mesure, en fonction des besoins du pouvoir, les gouvernants algériens pourraient bien se faire mordre. La tension sociale est à son comble dans ce pays ou la population profite à peine de la manne pétrolière. Et l’exaspération face à la corruption et aux petites manigances du pouvoir pourraient bien vaincre un jour les obstacles qui freinent un véritable renouvellement politique de l’Algérie par la base.
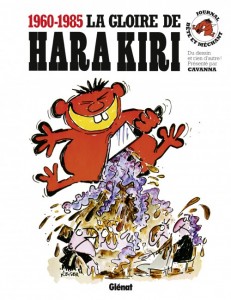



 Follow
Follow

